Le cancer du pancréas fait partie des cancers au pronostic le plus pessimiste, avec un taux de survie de seulement 11% à cinq ans 1. Le diagnostic est le plus souvent réalisé à un stade avancé de la maladie, lorsque la tumeur ne peut plus être opérée, du fait d’une expression clinique tardive de la maladie.
Bien qu’il n’arrive qu’au 12e rang des cancers diagnostiqués au niveau mondial en 2020, le cancer du pancréas est cependant le 7e le plus mortel². Ramené à la taille de la population, le nombre de nouveaux cas est en nette augmentation dans les pays industrialisés et plus particulièrement en Asie, ainsi qu’en Europe (notamment la France, la Belgique, l’Allemagne, ainsi qu’en Europe centrale et en Europe de l’est), en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Si ses causes demeurent peu connues, le tabagisme et la surconsommation d’alcool favorisent son apparition. Une alimentation trop riche en graisses et en protéines, l’obésité et le diabète pourraient aussi être impliqués. De nombreux cas surviennent toutefois en l’absence de ces facteurs, y compris chez des personnes âgées de plus de 60 ans. Dans 5 % à 10 % des cas1, une prédisposition familiale est observée. Des mutations de certains gènes, dont le BRCA2, déjà impliqué dans le cancer du sein et de l’ovaire, sont aussi en cause.
496 000
nouveaux cas sont survenus à travers le monde en 20202.
466 000
personnes sont décédées d’un cancer du pancréas en 20202.
70,2 %
c’est la hausse attendue du nombre mondial de cas en 2040, par rapport à 2020, du seul fait de l’évolution démographique3.
Le pancréas, organe crucial de la digestion
Un diagnostic trop tardif
Le mauvais pronostic du cancer du pancréas s’explique surtout par son diagnostic tardif : le patient ressent les premiers signes alors que le cancer est déjà à un stade avancé. Seuls 20 % des patients sont diagnostiqués à un stade encore opérable : chez eux, le taux de survie atteint 20 % cinq ans après le diagnostic – contre 5 %1 tous stades confondus, opérables ou non.
Entre autres symptômes, une perte d’appétit, un amaigrissement, des douleurs au niveau de l’estomac, pouvant s’étendre aux côtes et au dos. Si la tumeur touche la tête du pancréas, elle entraîne une compression du canal cholédoque, qui achemine la bile du foie à l’intestin. La bile reflue alors dans la circulation, entraînant un jaunissement des yeux et de la peau (ictère), des urines foncées, parfois des démangeaisons de la peau.
Le diagnostic repose sur l’imagerie, d’abord l’échographie abdominale, puis la tomodensitométrie. Celle-ci permet de préciser la taille de la tumeur et son éventuelle extension sous forme de métastases, vers les ganglions, le foie ou les os. Le diagnostic est confirmé par analyse tumorale, pour les tumeurs opérables, ou par biopsie, pour les non-opérables.
La chirurgie, seul traitement potentiellement curatif
La décision d’opérer le patient dépend de la taille et de la localisation de la tumeur, mais aussi de l’état général du patient (âge, présence d’autres maladies). Lorsque la tête du pancréas est touchée, l’acte chirurgical, appelé « opération de Whipple », consiste à retirer non seulement cette partie, mais aussi celles situées à proximité : le canal cholédoque, les parties adjacentes de l’estomac et de l’intestin. Il s’agit d’une opération lourde qui ne peut être proposée à tous les patients.
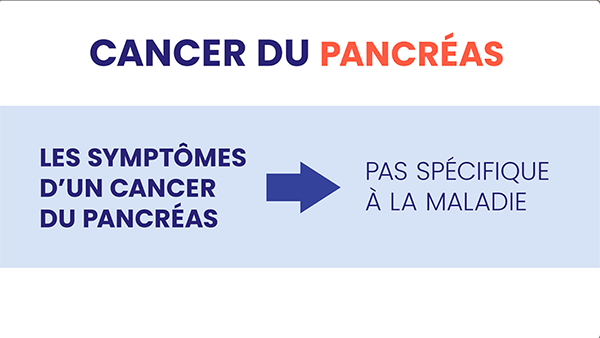
La chimiothérapie, une alternative thérapeutique
La chimiothérapie est systématique chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, qu’ils aient été opérés ou non. Les médicaments utilisés bloquent la prolifération des cellules. Ils ciblent donc les cellules à division rapide, qu’elles soient cancéreuses ou non – ce qui explique les effets indésirables de ces traitements.
Après opération, la chimiothérapie est dite « adjuvante » : elle vise à éliminer les cellules cancéreuses résiduelles, et donc à prévenir les rechutes. Dans certains cas, elle peut être pratiquée avant l’opération, afin de réduire la taille de la tumeur de manière à la rendre opérable : elle est dite « néo-adjuvante ». En l’absence d’opération, la chimiothérapie permet de contrôler la tumeur et d’atténuer les symptômes. Lorsque la maladie est à un stade avancé, elle repose le plus souvent sur l’association de plusieurs médicaments afin de combiner leurs actions.
La radiothérapie peut aussi être utilisée, en association avec la chimiothérapie, lorsque la tumeur est localement avancée mais non opérable, voire pour traiter les métastases osseuses, souvent douloureuses.
Dans 20 % des cas, il est possible d’associer la chimiothérapie à certaines thérapies ciblées. Ce qui, pour les patients, permet un traitement plus personnalisé.
À RETENIR

Et Servier ?
Guidés par les besoins des patients, nous visons à apporter des innovations thérapeutiques pour développer des traitements ciblant les cancers difficiles à traiter. Il s’agit en particulier des cancers digestifs (cancer gastrique, cancer du pancréas, cholangiocarcinome, ou cancer rare et agressif des voies biliaires), des gliomes (ou tumeurs cérébrales), des cancers hématologiques (leucémie aiguë myéloïde, leucémie aiguë lymphoblastique, lymphomes) ou des cancers pédiatriques.
Nous concentrons nos programmes de R&D sur deux approches : l’immuno-oncologie et les thérapies ciblées.
Nous avons renforcé notre écosystème de recherche sur le cancer avec Symphogen, notre centre d’excellence pour les anticorps monoclonaux au Danemark, et avec notre centre de R&D à Boston, aux États-Unis. Ce dernier centre concentre ses activités de recherche sur le développement de traitements innovants contre le cancer.
1 Source: American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2023. Atlanta: American Cancer Society; 2022.
2 Source: International Agency for Research on Cancer, Globocan 2020, WHO.
3 Long-term illnesses (ALD) Guide, pancreatic cancer, November 2010, French National Authority for Health (HAS).
4 Source: The Global Cancer Observatory, International Agency for Research on Cancer, 2023

